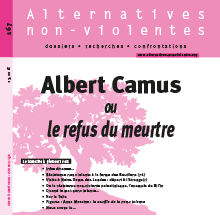Comment ne pas comprendre que l’écrivain Camus est resté marqué toute sa vie par la mort de son père au cours de la guerre de 1914-18 ? Il est décédé à Saint-Brieuc alors que son épouse et le jeune Albert habitaient à Alger, un quartier défavorisé.
Elle ne dit rien. Comme chaque soir, elle attend, assise derrière sa fenêtre, un mouchoir de batiste s’enroulant d’un index sur l’autre. Machinalement.
Dehors la rue est toujours aussi agitée. Le tram avance par à-coups en soubresauts et hoquets de sonnette qu’elle n’entend pas. Pas plus que les cris des hommes qui s’interpellent et des enfants qui hurlent avant de se faire happer par les couloirs sombres des maisonnettes sans charme s’alignant tout au long de la rue de Lyon. Tout juste ressent-elle les vibrations des vitres sous le choc d’une charrette qui se déleste de ses barriques au beau milieu de la rue. Un crépuscule mauve s’insinue dans les ruelles qui descendent vers la mer. Les réverbères ne tarderont pas à s’allumer. Albert rentrera bientôt de l’école. Un baiser sur le front avant les devoirs du soir à l’encre violette avec les pleins et les déliés. M. Germain est très strict sur la calligraphie… Attentif et exigeant, l’instituteur est sévère avec ses tramousses comme il appelle affectueusement ses élèves. Il leur enseigne la rigueur et la discipline tout autant que l’écriture et le calcul. Pas question de bâcler un devoir ou d’oublier sa leçon sans prendre le risque de goûter au sucre d’orge, une règle dont le bon maître assène quelques coups secs sur les doigts de l’élève indiscipliné. C’est sa manière de préparer chacun d’eux à la vie, à ses rigueurs. Avec ces armes pacifiques mais essentielles que sont les mots et les chiffres, la morale et l’histoire dont il sait qu’elle a tendance à hoqueter lui qui a échappé à la grande boucherie. C’est un peu le père de ces gamins dont la plupart sont orphelins de guerre. Ils n’ont pas connu leur père. On leur a raconté, comme à Albert, cette vie paisible brisée net par l’ordre de mobilisation. Celle de son père Lucien qui travaillait comme caviste chez Ricôme à Mondovi 1 , un petit village de l’Est bouffé de poussière et de moustiques. Les vendanges promettaient d’être bonnes et le vin titrerait au moins 13 degrés.
C’était hier. Aujourd’hui et demain encore dans la mémoire orpheline de son fils Albert…
Ulysse sans boussole
À peine a-t-il refermé son cahier de récoltes et prévenu le patron du domaine, que Lucien doit retirer son paquetage, se préparer à la hâte, embrasser sa femme et ses enfants et grimper sur une carriole qui va le conduire à la gare de Bône 2 . Et le voilà dans ce train bondé le conduisant dans un incessant chaos jusqu’au port…
Au petit jour Marseille sort de ses brumes tapageuses. La Bonne Mère indifférente, drapée dans son manteau d’or, regarde sans la voir la multitude qui remonte la Canebière en chantonnant La petite Tonkinoise. Encore un train qui hoquette, bondé de ses « soldats assoupis que sa danse secoue 3 » et qui déjà rompus de fatigue « laissent pencher leur front et fléchissent le cou… Cela sent le tabac l’haleine et la sueur 4 ».
Puis un nouveau quai de gare dans une ville grise. Lucien arbore fièrement son uniforme de zouave au gilet cintré et au pantalon garance en forme de sarouel. Le bonnet à gland vissé sur la tête, il s’en va d’un cœur léger, chassant les cauchemars de la guerre, convaincu qu’il sera de retour avant que les premiers coquelicots annoncent de beaux jours dans cette vallée de la Seybouse où il retrouvera femme et enfants. Il sera de retour pour goûter au vin de l’année après avoir fait une bouchée des Boches.
Albert parvient difficilement à imaginer ce convoi braillant des mots qui ne sont pas à lui. Des mots qui rassurent. Croient-ils qu’ils s’en reviendront si vite ces Ulysse sans boussole ? Comme tous les autres, Lucien « aurait voulu parler. Mais il n’avait rien à dire et les autres non plus. Sur leurs visages taciturnes se lisaient seulement le chagrin et une sorte d’obstination 5 ».
Bâillon de gloire bâillon
Le froid et l’angoisse vont bientôt prendre le pas sur un patriotisme chantant. Les soldats englués dans la bourbe réalisent très vite qu’ils ne viendront pas si facilement à bout de la ligne Siegfried…
Longue attente. Jusqu’à ce jour où la mère d’Albert a reçu le télégramme. N’était-ce pas une erreur ?
Elle s’est posé la question quand on le lui a lu… Pourtant une poignée de jours auparavant le facteur lui avait remis avec un large sourire une carte postale de Saint-Brieuc. Une carte représentant l’hôpital avec une croix tracée sur l’une des fenêtres du rez-de-chaussée. Son homme avait été blessé à la tête mais rien de grave. Il avait signé : « ton mari Lucien ». Elle pensait alors que c’était bien mieux ainsi. Il était à l’abri, au propre, mangeait à sa faim et bénéficiait de bons soins. Bientôt la guerre finirait. Tout recommencerait comme avant.
Pourtant le télégramme ne pouvait pas mentir : il annonçait la mort du père qui n’avait pas survécu à ses blessures. Le silence se superposait désormais à l’absence. Bâillon de la gloire pour un soldat vaincu.
Quelques jours plus tard, une sorte de bougnat cravaté et chapeauté de noir venait remettre à la jeune veuve des éclats d’obus retirés des chairs du héros… Sa tête tourna. Son corps tout maigre se répandit sur le carrelage, lui enlevant ses dernières bribes de mots. Elle qui avait des difficultés d’élocution allait désormais se réfugier dans un mutisme quasi permanent.
Porter sa croix de bois
lbert vivrait désormais dans le silence pluriel de l’appartement. Celui de la mère analphabète. Celui de la grand-mère qui ne parlait que pour commander ou punir. Celui de l’oncle tonnelier qui lui inspirera plus tard Les Muets 6 , une nouvelle dans laquelle des tonneliers en grève cèdent au diktat du contremaître et reprennent le travail faute de pouvoir exprimer leurs revendications avec ces mots qu’ils ne possèdent pas. Le verbe leur est étranger. C’est une arme — certes pacifique — dont Camus usera pour défendre ces humbles auprès desquels il a appris l’essentiel d’une morale simple : ne pas manquer à sa mère, respecter un homme à terre ou dans l’adversité. Se défier en toutes circonstances de la violence qui n’engendre jamais qu’une autre violence plus forte encore.
Du père, il ne subsiste qu’une photographie accrochée au mur de la salle à manger. Dans un cadre doré, avec la croix de guerre et la médaille militaire.
Cette guerre, ce devait être ça… Le récit que M. Germain leur avait fait à la fin de l’année. Un livre auquel il semblait attacher un grand prix. Un livre recouvert de papier d’emballage défraîchi. Si bien qu’on ne pouvait pas en lire le titre. Mais tous les gamins le connaissaient. Chaque après-midi avant que la cloche ne sonne il leur lisait un passage non sans appuyer au préalable sur le titre et son auteur… « Les croix de bois de Roland Dorgelès ». Un silence religieux suivait avant que le maître ne s’éclaircisse la voix en toussotant et reprenne le cours du récit : « Entre deux salves, on vit quelque chose s’agiter dans les trous d’obus, une forme se relever, un des survivants avait dénoué sa ceinture de flanelle, une large ceinture rouge, et, agenouillé sur le bord de son trou, à trente pas des Allemands, il agitait son fanion, le bras levé très haut… 7 »
Le maître ménageait un temps. Les enfants en blouses grises levaient les yeux vers lui, pressentant le pire…
« - Rouge ! Il demande qu’on allonge le tir, cria la tranchée.
Secs, tragiques, des coups de mauser claquèrent. Le soldat s’était recouché, touché peut-être… Des obus piochèrent encore le point maudit, arrachant un tourbillon de terre dans la fumée lourde. Anxieux, nous attendions que le nuage s’écartât…
Non, il n’était pas mort. L’homme se redressait en levant le bras très haut, il agitait sa ceinture d’un grand geste rouge. Encore une fois les Boches tirèrent. Le soldat retomba…
On hurlait…
- Salauds ! Salauds !
- Il faut attaquer, criait Gilbert hagard.
Entre deux bordées de tonnerre, le soldat se relevait toujours, son fanion au poing, et les balles ne le faisaient coucher qu’un instant. “Rouge ! Rouge !” répétait la ceinture agitée. Mais notre artillerie prise de folie continuait de tirer, comme si elle eût voulu les broyer tous. Les obus encerclaient le groupe terré, se rapprochaient encore, allaient les écraser…
Alors, l’homme se leva tout droit, à découvert, et d’un grand geste fou, il brandit son fanion, au-dessus de sa tête, face aux fusils. Vingt coups partirent. On le vit chanceler et il s’abattit, le corps cassé, sur les fils acérés dont les liens le reçurent 8 . »
Éclopé de cœur
Lemaître lisait tout en marquant de longs silences pour appuyer sur certaines séquences, certaines images douloureuses ou révoltantes. Comment ne pas leur faire partager son refus de la guerre quand, avec emphase, il les faisait entrer dans l’enfer de ces hommes exténués « qui défilaient avec un piétinement pressé d’enterrement attardé 9 » et avançaient vers nulle part « dans un brouillardde fatigue et de pluie 10 »… Voilà qui devait être encore plus douloureux que les combats, la peur chaque instant renouvelé de mourir sous une rafale de mitrailleuse ou dans un trou d’obus.
C’était donc ça la guerre. Cette bouillie de terreet de sang avec des remugles de peur et de sueur. Des images revenaient en sa mémoire. Comme tous les écoliers Albert gardait les bras croisés et écoutait avec respect le récit de Dorgelès. Il paraissait être celui de leur maître qui en était revenu sain de corps et éclopé de cœur et d’espoir. Dans ces moments muets comme un sépulcre, tous ceux dont le père était mort au combat — et ils étaient nombreux — en éprouvaient une sorte de fierté. Les autres n’auraient désormais que du respect pour ces héros fauchés en pleine jeunesse pour défendre la patrie. Héros, patrie, fierté… Monsieur Germain dissertait sur chacun de ces mots quand il refermait le livre à la couverture défraîchie.
« Mort pour la France en héros. » C’est ce qui était écrit sur la citation accompagnant la médaille du père héroïque mais définitivement muet. Jusque sur le socle d’un monument aux morts supportant un soldat de bronze tout aussi éteint. Comme fauché dans son élan patriotique, la vareuse figée dans un vent retenu.
La mère tourne lentement la molette de la lampe à pétrole. La flamme s’allonge. Des ombres dansottent sur les murs. Celles des rares meubles, de la vieille qui tire sa chaise, des phalènes qui se heurtent au verre de la lampe. Du père peut-être qui s’en revient dans le silence du crépuscule.
Un jour, il se rendrait au cimetière de SaintBrieuc pour se recueillir sur la tombe de ce Premier Homme chassé du jardin d’Eden pour défendre la liberté.
Quelle liberté ? Ils devaient se la poser cette question en avançant vers nulle part. « Sur le bord des fossés, leur file s’allongeait, croix de hasard, faites avec deux planches ou deux bâtons croisés. Parfois toute une section de morts sans nom, avec une seule croix pour les garder tous… 11 » Il imaginait son père dans cette cohorte qui n’était plus constituée que par des noms bientôt anonymes s’égrenant sur un monument de pierre ornant la place du village. Des sanglots montaient jusqu’à la gorge où il les bloquait dans une grosse boule de fonte. Il ne fallait pas pleurer. Ce serait indigne du fils d’un héros tué au champ d’honneur… Quelle expression bizarre. Albert ne connaissait que des champs sur lesquels les gamins du quartier improvisaient des parties de foot. Mais le champ d’honneur ? Sans doute était-il cerné d’arbres taillés au carré comme ceux de la rue Michelet. Peut-être même était-il festonné de drapeaux tricolores. Toujours est-il qu’on n’en revenait pas. Qu’on ne se serrait pas la main à la fin de la partie. Que personne ne gagnait vraiment… Ça, le maître l’avait expliqué à ses tramousses.
Une sirène montait de l’usine libérant des odeurs de café en cours de torréfaction. Elles se mêlaient à celle des oranges pelées que les ouvriers de la fabrique d’apéritif Amer Picon déversaient sur le trottoir. Femmes et enfants, tous venaient y puiser un dessert inespéré.
Quelques gamins se bousculaient pour avoir les fruits les moins touchés. Albert faillit se jeter dans la mêlée comme à son accoutumée. Il eut un petit mouvement de recul. Comme ça. Sans savoir au juste pourquoi. « On ne va pas se faire la guerre pour une orange… » Il s’éloigna en pensant confusément ce qu’il écrirait plus tard… « Quand une guerre éclate, les gens disent : ça ne durera pas, c’est trop bête. Et sans doute une guerre est certainement trop bête, mais cela ne l’empêche pas de durer. La bêtise insiste toujours. On s’en apercevrait si l’on ne pensait pas toujours à soi 12 . »
1) Aujourd’hui Dréan.
2) Aujourd’hui Annaba.
3) Poème de Louis Aragon : « La guerre et ce qui s’en suivit ».
4) Ibid.
5) Albert Camus, L’Exil et le royaume, Gallimard Folio, Paris, 1982, p. 78.
6) In L’Exil et le Royaume, Folio Gallimard, 1982, Paris, pp. 63 à 80.
7) Roland Dorgelès Les croix de bois, 1989, Paris Le Livre de poche / Albin Michel, p. 44
8) Ibid., pp. 44-45.
9) Ibid., p. 53.
10) Ibid., p. 53.
11) Ibid.
12) Albert Camus, La Peste, Folio Gallimard, Paris 2010, p. 41.