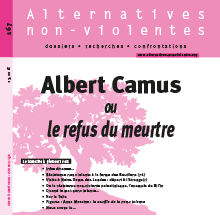Quelle est la corrélation philosophique entre les deux notions de mort et d’absurde chez Camus ? Comment cet écrivain a-t-il progressivement forgé, jusqu’à ses Réflexions sur la guillotine, une opposition raisonnée aux exécutions capitales ?
Faby qui, définitivement, a fait le choix du sérieux.
Je viens de relire pour cette étude la tétralogie que Camus considérait comme un « cycle de l’absurde » : L’Étranger, Caligula, Le Mythe de Sisyphe et Le Malentendu — à laquelle je rajouterai ici une lecture toute personnelle de La Chute, dont il m’aura fallu un drame pour comprendre enfin toute la sombre profondeur. Partout la mort, qui « n’est rien [qu’]une vérité toute simple et toute claire, un peu bête, mais difficile à découvrir et lourde à porter », est présente, et sous toutes ses formes, dans l’œuvre de Camus ; partout la mort, cul-desac de l’existence, « porte fermée [et] aventure horrible et sale1 », y est actrice, comme corollaire ou comme preuve de l’absurdité du monde.
L’amour, la mort, l’absurde
« L’absurde commande-t-il la mort ? » s’interroge Camus dans Le Mythe de Sisyphe — d’où l’on pourrait inférer en renversant la logique que la mort donnée, le meurtre, au même titre que la mort qu’on se donne, le suicide, constituent autant de solutions à l’absurde : « Juger que la vie vaut ou ne vaut pas d’être vécue » — grande question existentialiste autour de laquelle l’écrivain ne cesse de tourner : révolte contre la mort, conjurée dans l’action ou la solidarité, meurtre sous toutes ses formes (parricide, infanticide, régicide…), exécution capitale ou mort légiférée, mort consentie, enfin, « seul problème philosophique vraiment sérieux », au carrefour de tous ces questionnements.
Ce que je voudrais étudier ici, c’est précisément la corrélation philosophique entre les deux notions de mortet d’absurde,en écartant de ma réflexion tout autre dimension qu’éthique, qu’elle soit d’ordre politique (le terrorisme dans Les Justes ; les Réflexions sur la guillotine) ou morale (la mort des enfants dans La Peste ou à nouveau dans Les Justes).
C’est devant le corps martyrisé de l’être aimé que l’on se pose, comme Caligula, les seules questions qui méritent de l’être : qu’est-ce que l’amour ? que vaut la liberté d’agir ? À quoi bon s’engager, se révolter ? Sommes-nous responsables les uns des autres, et dans quelles limites ? C’est face à la mort de Drusilla que Caïus Caligula apprend combien « il est dur, […] amer de devenir un homme ». Avec la mort de celle qui symbolise l’amour total — par le sang elle est la sœur, par le cœur l’épouse — l’empereur perçoit l’absence du sens de son existence, en même temps qu’il mesure la signification de cet accomplissement : « Cette mort n’est rien, je te le jure. Elle est simplement le signe d’une vérité 2 … »
Une variante à laquelle Albert Camus est tout particulièrement sensible est la mort de l’enfant, épisode récurrent dans son œuvre : Les Justes, Requiem pour une nonne, et surtout l’interminable et atroce agonie du fils du juge dans La Peste en font preuve. Même lorsqu’elle n’est pas assassinat, la mort de l’enfant lui apparaît comme « le plus grand de tous les crimes, crime jusqu’alors inouï 3 » parce qu’à proprement parler insensé, preuve de l’absurdité du monde par l’absurde lui-même. C’est « à partir de là, prétend Philippe Forest, [que] l’individu peut dégringoler sur la pente du nihilisme, faire du suicide, du crime, les armes de représailles sauvages » au gré desquelles tout peut sembler permis 4 .
Meurtre ou « suicide interféré » ?
« Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement », prétend la Rochefoucauld dans l’une de ses Maximes. « Un peu plus tôt, un peu plus tard… » comme le souligne Caligula pour justifier sa démence assassine, chacun — qu’il le ressente ou non — est promis à cette échéance, qui, dans son évidence, ramène à l’absurde toute « l’épaisseur et l’étrangeté du monde ». Comme celle de Meursault dont le nom associe précisément soleil et mort, l’existence humaine se résume donc en une continuelle stratégie d’évitement de cette éclatante vérité, dans le divertissement pascalien ou dans des accommodements divers tels que « la religion, l’art, l’amour… tous ces précieux jouets qui nous aident à passer le temps » : la mort, « une vérité dont on s’arrange très bien » comme le prétend Hélicon dans Caligula, ou bien un drame qui peut conduire à la folie ou, comme Clémence à une mélancolie aux antipodes de la révolte.
Le meurtre ne me semble relever de l’absurde qu’à travers la question du hasard, « seule divinité raisonnable » (La Chute), puisque la victime ne peut ni prévoir ni prévenir sa mort : pour Zagreus (La Mort heureuse) comme pour l’Arabe (L’Étranger) ou pour Jan réintégrant la maison familiale (Le Malentendu), il constitue, d’une certaine manièreune « mortheureuse», puisqu’au fil de leur absurde condition de mortels, les victimes n’ont, ni les unes ni les autres, à considérer son terme avec angoisse ; à « regarder fixement » une mort qui leur est donnée par surprise.
En outre, il existe un parallélisme peu souvent établi entre Caligula, que la mort de Drusilla transforme en un fou meurtrier que ses excès de bourreau conduisent à devenir lui-même victime, et Meursault, incapable d’exprimer la douleur de la mort de sa mère et qui lui aussi, d’une certaine façon, tue pour se libérer de l’absurdité de son existence, pour laquelle il sera en fin de compte condamné. Deux formes différentes de suicide différé, inassumé, en somme.
La peine de mort
On sait combien Camus a progressivement forgé, jusqu’à ses Réflexions sur la guillotine 5, une opposition raisonnée aux exécutions capitales. Une scène du Premier homme, d’ailleurs reprise dans les Réflexions…, permet de saisir ce qui motive son point de vue : qu’est-ce qui peut justifier que le père de Jacques Cormery, comme des centaines d’autres Algérois, se soit levé à trois heures du matin, ce jour de l’exécution d’un « criminel fameux », afin d’assister à son supplice ? Solidarité avec cette « opinion publique » horrifiée par la violence d’un assassinat collectif ? Désir de se donner bonne conscience à peu de frais, dans l’anonymat d’un voyeurisme morbide : « L’exécution avait eu lieu sans incident, apparemment, mais le père de Jacques était revenu livide, s’était couché, puis levé pour aller vomir plusieurs fois, puis recouché. Il n’avait plus jamais voulu parler ensuite de ce qu’il avait vu… »
Au dénouement de L’Étranger, comme quelques années plus tard dans une lettre au Garde de Sceaux en faveur de la grâce des rédacteurs du journal collaborationniste Je suis partout 6 , c’est d’abord dans un effort d’empathie et d’imagination que Camus se place pour refuser la peine capitale, sans pour autant « diminuer la faute » commise : « Ces hommes, aujourd’hui, attendent tous les matins le moment de leur mort et j’ai assez d’imagination pour savoir qu’ils payent alors, dans l’angoisse et la mauvaise conscience, le prix le plus haut qu’un homme puisse payer pour ses crimes. »
Pendant des années, ce spectacle du condamné attendant seul face à tous l’heure fatidique de son supplice travailla l’imagination de l’écrivain. Pourtant, dans ses Réflexions sur la guillotine, il s’empresse de préciser qu’il serait « malhonnête de n’attribuer [s]a conviction qu’à la seule sensiblerie », avant de développer contre la peine de mort trois arguments de raison sur lesquels je ne m’arrêterai ici que pour souligner qu’en termes sociologiques, la peine capitale constitue aux yeux de Camus la négation de la solidarité humaine, un acte de lâcheté de ce monstre anonyme nommée « société ».
Le suicide, « seul problème philosophique vraiment sérieux »
Seul le suicidé — candidat non résigné, très opiniâtre au contraire, à sa propre mort — trouve ce courage de la regarder fixement depuis qu’il a pris conscience de l’absurdité du monde, et son apprivoisement de cet « instant […] semblable à celui où l’on s’éveille d’un rêve pénible, où l’on sort d’un cauchemar 7 ».
Le suicidé, selon Camus, n’a rien du nihiliste qui nie tout intérêt d’être au monde et, par son geste, souhaiterait entraîner son entourage en enfer avec lui ; il n’est pas davantage ce monstre d’égoïsme que, dans notre affliction blessée, nous avons quelquefois tendance à voir en lui (« Et tes proches, les enfants, les petitsenfants qu’en te donnant la mort tu laisserais seuls… est-ce que tu as pensé à eux ? »). S’il a vécu, totalement ou partiellement et quelle qu’en soit la raison, sa propre existence comme un enfer, celui qui se donne la mort suggère au contraire par son geste violent et la mise en scène qui souvent l’accompagne, la possibilité d’une existence autre — en laissant à son entourage la liberté de vivre et d’y trouver un sens que lui n’a pas su y trouver (« Tu referas ta vie, vous m’oublierez »… comme si l’on pouvait oublier, comme si l’on pouvait « refaire » une existence ainsi défaite !).
Ainsi le Clamence de La Chute, toujours empêtré dans la superficialité trompeuse d’un vouloir-vivre ordinaire, dans l’oubli ou la négation — ces « principes de tout repos » dénoncés dans Le Mythe de Sisyphe, habillant le récit du désespéré des réponses toutes faites du vieux patricien de Caligula.
Alors, exilés dans la grise ville étrangère, Clémence comme Caligula mesureront, tout deux inconsolés par la mort d’une très proche ou d’une anonyme, l’absurdité d’un monde où rien désormais « ne veut plus rien dire» (II,5). En dépit des distances, des brouillards de l’oubli, du bon sens moralisant de Caesonia ou des patriciens, toujours prodigues en phrases sibyllines, en vérités à deux sous 8 , tout travail du deuil leur apparaîtra vain.
Que faire alors ? Tenter dans un désespoir fou de peupler cet univers sans Dieu en se transformant, comme Caligula, en bras du Destin, capable de décider à son tour, et aussi arbitrairement, de la vie et de la mort ? Jusqu’à voir se retourner contre lui, non comme un aveu d’impuissance, mais dans la logique même du nihilisme qui le définit, l’arme qu’il a brandie face aux autres. Ou traîner comme Clamence sous des cieux toujours gris une culpabilité envahissante ?
Deux extrémités d’un absurde qui, selon Camus, « restitue au remords son inutilité » (L’Envers et l’endroit). « Si l’amour suffisait, avance alors Caligula, tout serait changé 9 . »
Suicide et peine de mort ont en outre en commun qu’ils placent l’individu dans une atroce tension, celle de cette attente solitaire et atrocement imaginative d’un acte — choisi dans le premier cas, non voulu dans le second — attente durant laquelle tout effort de croyance, de foi ou tout simplement d’altruisme (appelons-la amour, amitié, communauté d’intérêt ou d’affect) pour la réduire devient illusoire.
Conclusion
Ce n’est jamais en moraliste qu’Albert Camus l’agnostique considère la mort, aboutissement paradoxal de l’immanence, aux limites de la liberté, et preuve par l’absurde que si nous n’avons « pas d’action sur l’ordre de ce monde », nous n’avons pas davantage à attendre en une autre vie au-delà. Meursault dans l’attente de la sentence capitale après le meurtre qu’il a commis, Caligula provoquant sa propre mort dans une boulimie d’assassinats ou Clamence remâchant ses inutiles remords : c’est toujours, en humaniste, du côté de l’homme face à la mort, face à sa propre mort ou à celle d’autrui, que se place Camus. La grande question existentialiste posée en introduction est chez lui constamment sous-tendue par une autre dialectique, celle qu’entretiennent face à la mort solitude et devoir de solidarité.
1) « Il ne me plaît pas de croire que la mort ouvre sur une autre vie. Elle est pour moi une porte fermée. Je ne dis pas que c’est un pas qu’il faut franchir : mais que c’est une aventure horrible et sale », dans « Le Vent à Djemila », Noces, Œuvres complètes 1931-1944. La Pléiade, p. 113.
2) Caligula, acte I, scène 4.
3) Bossuet : Discours sur l’Histoire universelle, vol II, chap. XXXI.
4) « Albert Camus et l’infanticide », dans D. Lyotard éd : Albert Camus contemporain, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2009.
5) Dans A. Camus et A. Koestler : Réflexions sur la peine de mort, Calmann-Lévy, 1957.
6) Lettre au Garde des Sceaux, 5 décembre 1946, reprise dans Œuvres complètes. La Pléiade, vol II.
7) Schopenhauer, Métaphysique de l’amour, métaphysique de la mort.
8) À l’acte I de la pièce, les patriciens réunis tentent de consoler Caligula en multipliant les expressions toutes faites et autres lieux communs : « Une de perdue, dix de retrouvées » ; « …lâcher la proie pour l’ombre » (Caligula, acte I, sc. 1).
9) Caligula, Acte IV, scène 14.